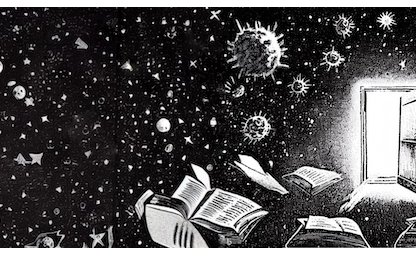A specter is, once again, haunting the United States and Europe – the specter of populism. Michael Kazin [1].
Introduction
A. Introduction générale
Le populisme n’a jamais fait couler autant d’encre. Des deux côtés de l’Atlantique, suite, notamment, au vote sur le Brexit et à l’élection de Donald Trump en 2016, des commentateurs politiques ont sonné l’alarme face à une « vague populiste » qui semblait menacer nos démocraties. De leur côté, des universitaires s’évertuent depuis de nombreuses années à définir un terme qui semble échapper à toute forme de consensus définitionnel. D’aucuns s’accordent ainsi pour dire que le populisme serait avant tout un « concept essentiellement contesté », dans le sillon de la définition qu’en avait donné Walter Bryce Gallie dans un article paru en 1956 [2]. En effet, la plasticité du terme en a fait un outil analytique privilégié, notamment dans le domaine médiatique, de telle sorte que des individus aux profils idéologiques pourtant aussi radicalement différents que Donald Trump et Bernie Sanders en sont tous deux venus à se voir qualifier de « populiste » en 2016 [3]. L’on peut dès lors légitimement se demander dans quelle mesure ce concept peut être considéré comme un outil d’analyse pertinent. Dans cet article, nous postulons que le terme de « populisme » permet d’éclairer la rhétorique et les rapports de force ayant conjointement caractérisé le mouvement Occupy Wall Street et la campagne présidentielle de Bernie Sanders en 2016. Nous nous proposons ainsi de revisiter la notion d’engagement politique au prisme de la notion de « populisme ».
Si les contours de la notion d’engagement politique restent mal définis, il n’en reste pas moins qu’elle constitue une caractéristique indispensable de la démocratie [4]. En ce sens, la question de la nature de l’engagement politique amène tout naturellement celle de la qualité de la démocratie. C’est précisément cette question de la démocratie qui est au cœur de la grille de lecture populiste. Le populisme est ici envisagé comme la réponse à la perception d’une crise touchant le système, l’idéologie dominante, ou bien, de manière plus générale, la démocratie. Dans les cas d’Occupy Wall Street (OWS) et de la campagne pour l’investiture démocrate de Bernie Sanders, les divers acteurs et actrices engagé.e.s dans ces mouvements mobilisèrent en effet un discours populiste afin de fédérer diverses revendications autour d’une demande collective de démocratisation de la vie publique et politique.
B. Crise de la démocratie et populisme
Longtemps considérée comme une panacée, la démocratie se trouve aujourd’hui assez largement décrédibilisée aux yeux d’une partie de la population. Yves Mény et Yves Surel, parmi d’autres, font état d’une démocratie qui serait à bout de souffle aux États-Unis, mais aussi ailleurs, ce qui se caractériserait, notamment, par une érosion de l’avantage dont jouissaient jusqu’ici les élus sortants (incumbents), une augmentation de l’abstentionnisme électoral, la volatilité partisane de l’électorat, la polarisation toujours plus importante au cœur du bipartisme, l’émergence de mouvements sociaux ad hoc indépendants des organisations politiques traditionnelles, et l’apparition de partis politiques radicaux et/ou à cause unique [5]. Robert Dahl indique que, même dans les pays où la démocratie s’est fermement implantée, certains observateurs considèrent qu’elle serait en crise, ou du moins que sa légitimité se serait sévèrement érodée du fait d’une perte de confiance des citoyens dans la capacité ou la volonté de leurs représentants, des partis politiques et des élus gouvernementaux à résoudre des problèmes liés à la montée du chômage, à la pauvreté, au crime, aux programmes d’aide sociale, à l’immigration, à l’imposition, ou encore à la corruption [6].
Des études mettent effectivement en évidence un certain désenchantement de la population étatsunienne à l’égard du fonctionnement des institutions du pays. Dans une enquête publiée en avril 2018, le Pew Research Center révèle que bon nombre d’Américains estiment que la démocratie étatsunienne n’est pas à la hauteur de ses idéaux [7] et met en évidence une forme de cynisme envers la politique. Face à l’érosion de la légitimité du système démocratique et de son fonctionnement, il convient de s’interroger sur les causes ou origines de ce phénomène. Tout particulièrement depuis le vote sur le Brexit et l’élection de Donald Trump en 2016, les médias et le commentaire politique font état d’un « moment populiste » souvent analysé comme la manifestation d’un certain mécontentement irrationnel du peuple envers ses dirigeants [8]. Malgré son manque de clarté conceptuelle, le populisme ferait ainsi office de responsable transversal. C’est d’ailleurs précisément sa forte plasticité qui rend ce terme particulièrement utile en ce qu’il permet de rendre compte très sommairement et très superficiellement de phénomènes aux causes extrêmement complexes et diverses. C’est également là que réside son danger potentiel.
Dans son acception la plus simple, le populisme implique nécessairement un clivage opposant « le peuple » aux « élites » [9]. En outre, le trait discursif distinctif du populisme repose sur une revendication de défense des intérêts du peuple, lequel est perçu comme moralement supérieur aux élites. Or la notion de « peuple » est extrêmement vague et recouvre diverses interprétations, souvent incompatibles. Loin d’aller de soi, la notion de peuple fait toujours l’objet d’une construction et sa signification dépend du contexte idéologique dans lequel elle s’inscrit. Selon Ernesto Laclau et Chantal Mouffe [10], « le peuple » n’est jamais conçu comme un référent empirique mais comme un signifiant vide, un objet politique construit à travers le discours et qui ne préexiste pas à son articulation performative. C’est précisément à travers ce processus d’articulation qu’une chaîne d’équivalences est créée entre diverses revendications sociales et politiques jusqu’alors insatisfaites. Le peuple se retrouve ainsi uni soit par l’identification commune à un leader ou à une demande symbolique. De manière très similaire, la notion d’« élite » est elle aussi sujette à différentes interprétations selon le contexte dans lequel elle est mobilisée. Si la distinction entre peuple et élite est avant tout d’ordre moral, dans la mesure où l’élite est décrite comme corrompue et opposée à la volonté générale du peuple [11], la notion peut prendre des inflexions très différentes dépendant du programme ou de l’idéologie qu’elle accompagne. Si l’élite est avant tout définie en terme du pouvoir qu’elle exercerait, ce critère peut être décliné et entendu de diverses manières, soit en termes politiques, économiques, ou encore culturels. Aux États-Unis, une certaine gauche populiste définit ainsi l’élite principalement en termes économiques et politiques, à l’image du slogan initié par le mouvement Occupy Wall Street, opposant les 99% aux 1% [12], et accuse l’establishment politique et économique de mettre en péril la souveraineté populaire. De son côté, la droite populiste contemporaine, dans le sillon du mouvement Tea Party ou de Sarah Palin, notamment, tend à dépeindre l’élite en termes culturels, dénonçant les libéraux bien-pensants de la côte Est en invoquant l’image d’une élite condescendante et sophistiquée [13] et déconnectée de la culture authentique des « vrais » Américains.
Ainsi, le populisme peut être compris de manière minimale comme un style ou un langage qui mobiliserait une opposition peuple-élite, elle-même sous-tendue par un argument moral. Il incarnerait en outre une réaction au déficit démocratique qui distingue les démocraties représentatives, et serait fondamentalement caractérisé par une demande de souveraineté populaire et d’approfondissement de la démocratie. Le populisme apparait donc comme un phénomène à géométrie extrêmement variable, pouvant se greffer à des idéologies diverses et variées, de droite comme de gauche, et qui entretient un lien extrêmement étroit avec la démocratie. La relation entre démocratie et populisme a d’ailleurs fait l’objet de longs et houleux débats entre intellectuels, notamment au sein du milieu universitaire. Si aucun consensus n’a été atteint, ces débats mettent toutefois en évidence la très forte intimité qui lie ces deux termes. En témoigne la position de Nadia Urbinati, pour qui l’un ne peut se concevoir sans l’autre, puisque « la démocratie et le populisme vivent et meurent ensemble » [14], ou encore celle de Gregor Fitzi, qui explique que populisme et démocratie représentent les deux faces d’une même pièce, puisqu’aucun des deux ne peut survivre sans se référer à la « souveraineté du peuple » [15]. L’analyse la plus courante de leur relation consiste à concevoir le populisme comme une sorte de pathologie de la démocratie. Cette analyse est particulièrement répandue dans le commentaire politique, où la montée du populisme est assimilée à une vague anti-démocratique dont il conviendrait à tout prix de freiner la progression [16]. C’est également la position défendue par Jan-Werner Müller, qui, adoptant une approche « par le haut » (« top-down »), estime que le populisme représenterait un phénomène éminemment anti-démocratique dans la mesure où il incarnerait des tendances à la fois anti-pluralistes et une forme de « politique identitaire » qui viserait à exclure une partie de la population [17]. Le populisme, explique-t-il, déforme le processus démocratique [18] car les populistes véhiculent une vision extrêmement restrictive du « peuple », dont ils se réclament les représentants exclusifs [19]. Pour Müller, les populistes ne sont pas intrinsèquement antiélitistes ; ils sont tout à fait disposés à accepter les élites dès lors qu’ils sont eux-mêmes les élites qui dirigent le peuple [20]. Benjamin Arditi explique quant à lui que le populisme doit être conçu comme le « spectre » de la démocratie qui tout à la fois l’accompagne et la hante [21]. Ainsi, le populisme se présente « comme le retour du refoulé, comme un symptôme de la démocratie, comme un élément interne au système démocratique qui en révèle à la fois les limites » [22]. Arditi met en garde contre les dangers que représente le populisme ; si celui-ci peut s’épanouir en tant que compagnon de route de la démocratie, il peut, à travers son invocation continue de l’unité du peuple, également la compromettre en sapant le pluralisme et la tolérance [23]. Dans leur approche idéationnelle du populisme, devenue hégémonique au sein des sciences sociales, Mudde et Kaltwasser estiment que le populisme est « essentiellement démocratique, mais en désaccord avec la démocratie libérale. […] Le populisme estime que rien ne devrait entraver ‘la volonté du peuple (pur)’ et rejette fondamentalement les notions de pluralisme et, de ce fait, de droits des minorités, ainsi que les ‘garanties institutionnelles’ qui servent à les protéger » [24]. Selon eux, le populisme peut, en fonction de sa force électorale et du contexte dans lequel il intervient, représenter tout aussi bien un danger qu’un correctif pour la démocratie [25]. Au-delà de la question de la nature démocratique du populisme, un consensus s’est établi autour du fait que le populisme puise son origine dans une crise de la représentation politique. Présentée de manière très simplifiée, la problématique populiste ne serait autre qu’« une réaction politique primitive des dirigés envers leurs dirigeants » [26]. En ce qu’il implique nécessairement un clivage opposant « le peuple » aux « élites » [27], le populisme interroge le fonctionnement et le caractère démocratique du système représentatif. Selon Müller, le populisme ne serait autre que l’« ombre » [28] de la démocratie représentative et serait inhérent à la mise en place de celle-ci. La multiplication de phénomènes « populistes », porteurs de revendications de souveraineté populaire, informent effectivement le diagnostic d’une crise de la démocratie représentative, qui se manifesterait par une déconnexion, réelle et/ou ressentie, entre les représentés et leurs représentants. Ce que dénoncent les mouvements populistes, c’est l’usurpation de la souveraineté populaire, sur laquelle repose pourtant une grande part de la légitimité des systèmes démocratiques.
Cet article souhaite ainsi montrer que le mouvement Occupy Wall Street et le discours de campagne de Bernie Sanders s’inscrivent dans le sillage d’une tradition populiste caractérisée par une volonté de défendre les intérêts du « peuple » et de démocratiser la politique étatsunienne, perçue comme l’apanage d’une élite déconnectée du peuple qu’elle prétend représenter. Il s’agira dans un premier temps de replacer le terme dans son contexte historique et national, afin de mettre en évidence une tradition populiste contestataire proprement étatsunienne. Nous nous intéresserons dans un second temps à l’impact de la crise financière de 2008 sur le renouveau d’une gauche que l’on pourrait qualifier de « populiste », et qui, propulsée dans l’espace publique et médiatique par le mouvement Occupy Wall Street, se transforma en véritable croisade politique sous l’égide du désormais célèbre sénateur indépendant du Vermont, Bernie Sanders.
I. Le populisme dans le contexte étatsunien
Si la notion de « populisme » est souvent connotée négativement dans le contexte européen, où elle se retrouve régulièrement utilisée comme synonyme de « démagogie » et associée à l’extrême droite, elle recouvre une réalité sensiblement différente outre-Atlantique, où le concept renvoie à un Parti populiste (ou People’s Party) fondé à la fin du XIXe siècle et dont les revendications s’inscrivirent dans une veine assurément progressiste. De par cette association, le terme « populisme » a historiquement été perçu moins négativement dans le contexte étatsunien. C’est ce que souligne l’historien Daniel Critchlow :
American populism can be distinguished from populism in Europe and other regions in the world. American populism is distinctive in its demand for more direct democracy and greater ambivalence toward a strong leader to save the nation. Furthermore, within the American tradition, at least since the founding of the nation, populist rhetoric has been a constant refrain. Aspiring candidates and incumbents alike rail against the establishment, the need to clean up government, and the demand to throw the rascals out [29].
Afin de mieux comprendre la portée du populisme dans le contexte des États-Unis, il convient de revenir brièvement sur les origines de ce terme.
La période historique connue sous le nom de Gilded Age (1865-1901), littéralement « âge doré », fut, entre autres, caractérisée par une croissance économique sans précédent et une expansion extraordinaire de l’économie industrielle des États-Unis. Durant les trois dernières décennies du XIXe siècle, les États-Unis connurent une accélération fulgurante de leur économie, qui fut nourrie de changements tels que l’apparition de nouvelles technologies, notamment dans le domaine de la production de l’acier, ou encore l’implantation de nouvelles formes d’organisation corporative. Cette période fut également marquée par une transformation physique du paysage du pays, liée en grande partie à la croissance des villes et à l’essor des chemins de fer, ainsi que par une altération du paysage social, liée, cette fois-ci, à la concentration toujours plus importante des nouvelles richesses créées. Ainsi, les dernières décennies du XIXe siècle virent l’émergence de géants industriels et de monopoles capitalistes qui donnèrent naissance à de grandes fortunes, à l’image de celles de J.P. Morgan (1937-1913) dans le domaine de la finance, d’Andrew Carnegie (1835-1919) dans l’acier, et de J. D. Rockefeller (1839-1937) dans le pétrole. En parallèle, une classe moyenne de plus en plus vaste, essentiellement composée de cols blancs, vit également ses conditions de vie s’améliorer de manière significative. En revanche, la prospérité amenée par l’industrialisation ne profita certainement pas à tous les Américains, et une frange de la population, composée essentiellement d’ouvriers et de fermiers, soufra démesurément de la transition économique que traversait le pays.
Dans le Midwest et les régions des Grandes Plaines, les fermiers se trouvèrent confrontés à des conditions économiques particulièrement rudes, devant faire face à des cycles de fluctuations importantes des prix agricoles et à un système de crédit excessivement contraignant (crop-lien system) et très répandu parmi les producteurs de coton du Sud entre 1860 et 1930 [30]. L’adversité endurée par les fermiers poussa ces derniers à développer des formes de solidarité. Dès 1875, à la suite de la dépression économique sévère qui toucha le pays au milieu des années 1870, plusieurs coopératives agricoles se rassemblèrent pour former la Farmers’ Alliance, qui devint le principal véhicule de protestation dans les régions agraires du Sud et du Midwest. C’est seulement en 1892, et après l’échec électoral du Union Labor Party en 1888, que ce mouvement de solidarité se mua en mouvement politique, avec la formation du People’s Party, ou Populist Party, lors de la conférence de St. Louis, qui mena à l’adoption, le 4 juillet, de la Plateforme d’Omaha. Rédigé par Ignatius Donnelly, ce document dénonça les inégalités économiques, qui avaient, selon les Populistes, abouti à une nation divisée en deux classes : celle des clochards, et celle des millionnaires : « From the same prolific womb of governmental injustice we breed the two great classes—tramps and millionaires » [31].
Face à une augmentation exponentielle des inégalités économiques et à une concentration toujours plus grande des richesses produites, les Populistes entreprirent une inflexion du libéralisme jeffersonien, lequel prônait la non-intervention de l’état dans les affaires économiques, et qui avait jusqu’alors bénéficié d’un statut hégémonique. En effet, les Populistes arguèrent que le nouveau contexte économique rendait nécessaire une adaptation de la doctrine libérale, afin que celle-ci puisse continuer à garantir les idéaux d’égalité et de liberté qui la sous-tendaient. Lors de la convention du Parti démocrate de juillet 1896, le candidat William Jennings Bryan, qui s’inscrivit à bien des égards dans le sillon rhétorique du mouvement populiste dont il coopta tout à la fois le message et certaines revendications, prononça son célèbre discours de la Croix d’or, expliquait que les principes éternels sur lesquels est fondée la démocratie devaient être adaptés aux nouvelles conditions économiques :
They tell us that this platform was made to catch votes. We reply to them that changing conditions make new issues ; that the principles upon which rest Democracy are as everlasting as the hills ; but that they must be applied to new conditions as they arise. Conditions have arisen and we are attempting to meet those conditions [32].
En outre, les Populistes mirent en évidence la discordance entre d’une part la promesse démocratique contenue dans le Préambule de la Constitution (« We, the people … ») et la réalité du fonctionnement des institutions étatsuniennes, caractérisé par une volonté de mise à distance du peuple vis-à-vis du processus décisionnel [33]. Au fond, le mouvement populiste chercha à concrétiser la promesse de souveraineté populaire telle que formulée par la Constitution et incarna une réaction de désillusion à l’égard de cette promesse. La plateforme d’Omaha entendait ainsi restituer au peuple le contrôle du pays et du système capitaliste. Dans le préambule de la plateforme, l’on peut ainsi lire :
Assembled on the anniversary of the birthday of the nation, and filled with the spirit of the grand general and chief who established our independence, we seek to restore the government of the Republic to the hands of “the plain people,” with which class it originated. We assert our purposes to be identical with the purposes of the National Constitution ; to form a more perfect union and establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty for ourselves and our posterity [34].
En reprenant la Constitution, les Populistes ont cherché à légitimer leurs revendications et à se présenter comme les défenseurs des principes énoncés dans le texte fondateur, et notamment de sa promesse de souveraineté populaire. En effet, les raisons de l’émergence du mouvement populiste sont directement liées à l’existence d’une tension, perceptible dans la Constitution, entre gouvernement par le peuple et mise à distance de ce dernier par voie de représentation. Comme l’explique Margaret Canovan, c’est dans cette tension que peut s’immiscer le populisme afin de réclamer que la promesse américaine soit réalisée. Selon Canovan, le discours populiste fait partie intégrante du discours contestataire étatsunien justement pour cette raison. Le populisme représenterait ainsi une sorte de levier démocratique inhérent à la démocratie étatsunienne : « The discourse of appeals to ‘the people’ is indeed so thoroughly domesticated in American political culture that ‘populism’ has fewer derogatory associations in the USA than in Europe, allowing professional politicians actually to claim the title » [35]. Canovan fait ainsi écho à l’analyse de Michael Kazin, pour qui le populisme serait un langage contestataire ayant permis à différents mouvements d’exprimer leur mécontentement, sans toutefois remettre en question le système dans sa totalité : « Through populism, Americans have been able to protest social and economic inequalities without calling the entire system into question » [36]. En accusant les pouvoirs en place de violer les principes mêmes de la Constitution, le populisme se serait imposé comme le langage contestataire par excellence dans le contexte étatsunien, et puiserait sa force de conviction dans le fossé entre les idéaux énoncés par la Constitution et les institutions qui les ont trahis. En cela, la tradition populiste étatsunienne incarnerait une tendance profondément démocratique, à l’instar de la description qu’en donne Laura Grattan : « America’s grassroots populist tradition harbors a persistent democratizing aspiration. All populisms animate the ideal of popular sovereignty by mobilizing the aspirations of ordinary people to exercise power over their everyday lives and their collective fate » [37]. Selon Grattan, l’imaginaire populiste aurait ainsi permis à des contre-courants idéologiques de se développer et donc de pointer du doigt des alternatives au statu quo : « What I refer to in this book as America’s populist imaginary has historically been a prominent countercurrent to the liberal, capitalist social imaginary that has been dominant in the United States » [38].
Le populisme, qu’il soit de droite ou de gauche, se niche donc au cœur de la profonde tension qui sous-tend l’idéologie de la Constitution des États-Unis, entre reconnaissance de la souveraineté du peuple (« We the People ») d’une part, et mise à distance de ce dernier d’autre part, et c’est en ce sens qu’il peut être compris comme une réponse à la crise de la démocratie représentative ; le populisme cherche à concrétiser la promesse démocratique et représente donc une possibilité permanente de la démocratie. Aux États-Unis, en particulier, l’ambiguïté de la Constitution à l’égard de la démocratie permet au peuple de régulièrement mobiliser la promesse démocratique, prise au pied de la lettre, afin de s’insurger contre le fonctionnement élitiste du modèle étatsunien. La dichotomie peuple – élite mobilisée par les populistes fait ainsi écho à la tension constitutive contenue dans la Constitution des Etats-Unis, tiraillée entre une volonté d’établir un gouvernement populaire et le souhait de tenir le peuple à une distance raisonnable et prudente du processus décisionnel.
II. La crise de 2008 comme catalyseur.
A. Des espoirs déçus.
La crise de 2008 fut un véritable tsunami économique et financier, touchant des millions de foyers étatsuniens qui se trouvèrent dans l’impossibilité de rembourser leurs prêts immobiliers et mettant les banques du pays au bord de la faillite. Si la crise surgit lors de la présidence du Républicain George Bush (2001-2009), c’est à son homologue démocrate, élu en novembre 2008, que revint la difficile tâche de sauver l’économie du pays et de venir en aide aux Américains dans la détresse. Une crise d’une telle ampleur représente souvent un moment de remise en question des paradigmes dominants. En l’occurrence, l’arrivée au pouvoir de Barack Obama, dont la rhétorique de campagne « volontariste » [39] avait entretenu des espoirs de changement, symbolisés par le slogan « Yes we can », contribua à véhiculer l’idée que l’orthodoxie néolibérale touchait à sa fin et que le pays se préparait à l’avènement d’un « nouveau New Deal », nouvelle ère d’interventionnisme étatique de grande ampleur en faveur des plus fragiles [40]. Mais l’enthousiasme fut de courte durée. Après avoir nommé aux postes de responsabilité d’anciens conseillers de Bill Clinton (Lawrence Henry Summers et Rahm Emmanuel, notamment), Obama se lança dans un plan de sauvetage des banques (les fameux bailouts) qui troubla une grande partie de la population, et consterna littéralement la gauche. De plus en plus, un fossé se creusa entre l’establishment du Parti démocrate et sa base militante (grassroots). À l’échelle du pays, une désillusion vis-à-vis du système politique s’installa progressivement et s’exprima d’abord à droite, avec l’émergence, dès le début de la présidence Obama, du mouvement dit du Tea Party, puis à gauche, avec l’émergence, le 17 septembre 2011, d’Occupy Wall Street (OWS). Ce qui avait commencé comme une crise économique et financière fut progressivement réinterprété comme une crise plus systémique et globale dans un prisme polarisé : une crise du libéralisme démocrate pour la droite, et une crise du néolibéralisme et du fonctionnement de la démocratie américaine pour la gauche.
B. Les 99%.
Le 15 février 2010, le journaliste et activiste américain David DeGraw avait publié sur le site internet AmpetStatus.com le premier volet d’une suite de six articles, intitulé « The Economic Elite vs. The People of the United States ». Quelques mois plus tard, alors que son site avait été mystérieusement hacké, DeGraw collabora avec le groupe Anonymous pour former une nouvelle plateforme nommée A99. En mars 2011, le groupe appela à l’occupation de Zuccotti Park, situé près de Wall Street, dans le sud de la presqu’île de Manhattan à New York. Deux mois plus tard, ce même groupe s’allia avec un autre groupe new yorkais, la New York City General Assembly, qui s’opposait aux mesures d’austérité budgétaire de la ville. En juin, ce fut au tour du magazine anticapitaliste canadien Adbusters d’appeler à l’occupation de Wall Street pour le 17 septembre.
L’occupation commença donc à la date fixée par Adbusters. Les occupant.e.s étaient en majorité jeunes, éduqué.e.s, et blanc.che.s. Outre sa démographie, ce qui caractérisa OWS furent ses penchants nettement (néo-)anarchistes [41]. Un certain nombre des activistes qui gravitèrent au cœur du mouvement, dont David Graeber et Marina Sitrin, avaient d’ailleurs été impliqués dans les mouvements altermondialistes des années 1990. Ce qui amena ces personnes à se rassembler fut un sentiment profond d’injustice, lié notamment à la gestion de la crise de 2008, ainsi qu’une impression d’aliénation vis-à-vis du système politique et de sa classe dirigeante. Ainsi, le mouvement se caractérisa par un rejet radical des logiques politiques et partisanes, refusant de formuler quelques demandes que ce soit et rejetant toute forme de hiérarchie à l’intérieur du mouvement lui-même. Cela se traduisit par une revendication radicale d’autonomie visant à éviter toute forme de récupération politique par la classe dirigeante et par un refus de tout type de leadership, au profit d’une organisation horizontale et profondément égalitaire. OWS se posa ainsi comme le défenseur « du peuple » contre les intérêts financiers, et notamment ceux de Wall Street, et adopta un langage populiste reflété dans son slogan « We are the 99% ». En somme, OWS était un mouvement intrinsèquement hybride, représentant la convergence d’un populisme impulsé par celles et ceux directement touché.e.s par la crise économique et d’un activisme néo-anarchiste émergeant à la suite d’une période de relative inactivité [42].
Au sein du campement d’OWS se développa un ethos profondément démocratique, irrigué par une panoplie de rituels visant à la fois à promouvoir le bon fonctionnement du campement et à instaurer parmi ses membres un sentiment communautaire. Les valeurs de solidarité et d’inclusion furent partie intégrante de l’identité du mouvement et permirent à ce dernier de se distinguer du statu quo politique. Caractérisée par une recherche constante du consensus, la forme de démocratie participative qui se développa à Zuccotti Park était emprunte d’une dimension « préfigurative » par laquelle l’idéologie du mouvement devint inséparable de la forme du mouvement lui-même. Il s’opéra, selon Blair Taylor, une fusion de la forme et du contenu : la forme devint le contenu et les objectifs politiques devinrent synonymes et indissociables de la forme du mouvement, résultant en une sorte d’« idéologie anti-idéologique » [43].
Si, dans une tentative d’échapper aux logiques partisanes et politiques, OWS refusa d’énoncer une liste de doléances précises, il n’en reste pas moins que les sympathisants de ce mouvement se trouvèrent unis par une volonté, que l’on pourrait qualifier de « populiste », de redonner au peuple la souveraineté qui lui revenait de droit. Comme le montrent Michael Kazin ou Laura Grattan, la tradition populiste étatsunienne se caractérise effectivement par une volonté de satisfaire la promesse démocratique énoncée dans la Constitution. C’est précisément dans la contradiction entre la promesse de souveraineté populaire énoncée par la Constitution (« We, the people… ») et le fonctionnement élitiste de la démocratie représentative – ce que Margaret Canovan nomme les « deux visages de la démocratie » [44] – que le populisme trouve sa raison d’être. La seconde manière dont OWS s’est inscrit dans la tradition populiste a trait à sa focalisation sur les questions économiques, et notamment celles liées à l’inégalité. Le mouvement contribua en effet à (re-)populariser un discours de classe, longtemps évincé par la classe politique étatsunienne, et notamment par le Parti démocrate. Celui-ci avait en effet voulu voir l’accroissement de la classe moyenne dans la période d’après-guerre comme le signe de la fin de la lutte des classes et de l’avènement d’une société véritablement « sans classe » (classless). Le discours de « populisme économique » (economic populism) véhiculé par OWS se démarqua ainsi radicalement du discours centré sur les questions « identitaires » qui avait caractérisé la gauche depuis la fin de années 1960. Le discours universaliste d’OWS reflétait une volonté d’abandonner un discours de gauche jugé trop clivant et ainsi de former une coalition majoritaire, unie à la fois par une volonté de restituer au peuple sa souveraineté et par une opposition vigoureuse à l’égard des élites économiques et politiques.
Si l’impact politique d’OWS fut relativement éphémère, notamment en raison de la réticence de ses membres à engager une véritable bataille politique et à s’associer à un parti politique, ses répercussions sur le débat public furent incontestables. Le mouvement imposa décidément la question des inégalités de richesse au cœur du débat public et politique et le slogan des « 99% » prit une tournure symbolique reflétant la montée en puissance du discours populiste initié par OWS. Matthew Bolton et al. expliquent :
The Movement has heightened the urgency and visibility of the issue of economic inequality. Ninety-nine percent is not only a number now, it is a symbol, a discourse, an idea. OWS reawakened a broad-based social movement in the United States that spanned nearly every state and reached beyond national boundaries [45].
Le 11 janvier 2012, une étude menée par le Pew Research Center mettait en évidence l’impact d’OWS sur la perception d’un conflit de classe aux États-Unis. L’étude montra que 66% de la population estimait désormais qu’il existait des disparités « importantes », voire « très importantes », entre riches et pauvres, dans des proportions en augmentation de 19% par rapport à une étude de 2009 [46]]. Si cette perception était davantage répandue chez les électeurs démocrates et les progressistes (liberals), elle avait également gagné du terrain chez les Républicains et les Indépendants.
Pour sa part, le président Obama, dans un discours prononcé le 6 décembre 2011 à Osawatomie, dans le Kansas, fit écho aux griefs du mouvement, définissant la question des inégalités économiques comme la « question déterminante de notre siècle » (« the defining issue of our times »), tout en détournant la rhétorique d’OWS dans une tentative de rassemblement de la nation autour de valeurs communes :
[…] I believe that this country succeeds when everyone gets a fair shot, when everyone plays by the same rules. These aren’t Democratic values or Republican values. These aren’t 1% values or 99% values. They’re American values. And we have to reclaim them [47].
Cinq années plus tard, Bernie Sanders reprit là où s’était arrêté OWS en imposant la thématique de l’inégalité économique dans la campagne présidentielle de 2016. Le mouvement des 99% fit ainsi figure de catalyseur politique pour le programme populiste de Sanders et permit à ce dernier de lancer un mouvement politique populaire autour d’un discours de classe assumé.
III. Occupy the Democratic Party.
Le 26 mai 2015, sur les rives du lac Champlain dans la ville de Burlington (Vermont), le sénateur indépendant du Vermont annonça officiellement sa candidature à l’élection présidentielle, donnant ainsi le coup d’envoi pour une véritable « révolution politique » : « Today, with your support and the support of millions of people throughout this country, we begin a political revolution to transform our country economically, politically, socially and environmentally ». Dans ce même discours, Bernie Sanders exposa son projet politique, lequel se basait sur une analyse de la société étatsunienne comme étant profondément divisée en deux classes antagonistes :
Let me be very clear. There is something profoundly wrong when the top one-tenth of 1 percent owns almost as much wealth as the bottom 90 percent, and when 99 percent of all new income goes to the top 1 percent. There is something profoundly wrong when, in recent years, we have seen a proliferation of millionaires and billionaires at the same time as millions of Americans work longer hours for lower wages and we have the highest rate of childhood poverty of any major country on earth. There is something profoundly wrong when one family owns more wealth than the bottom 130 million Americans. This grotesque level of inequality is immoral. It is bad economics. It is unsustainable. This type of rigged economy is not what America is supposed to be about. This has got to change and, as your president, together we will change it [48].
La dichotomie des 1% contre les 99%, popularisée cinq années auparavant par OWS, fournit à Bernie Sanders une grille de lecture efficace pour véhiculer son message politique centré autour de la question des inégalités économiques. Comme l’explique Nicolas Gachon, OWS joua en effet le rôle de détonateur politique pour la campagne et le message du Sénateur : « The Occupy Wall Street movement was highly significant in that its success lay in the symbolic order. It was the detonator that propelled Bernie Sanders to boldly run in the 2016 presidential election » [49].
Le profil politique de Bernie Sanders est foncièrement atypique dans la mesure où celui-ci se positionne intentionnellement en dehors du courant principal (mainstream) politique. Ce statut d’outsider est d’autant plus mis en exergue que Sanders endosse l’étiquette « socialiste », dans une posture électoralement risquée dans un pays comme les États-Unis, où le socialisme est connoté négativement et était jusqu’à très récemment associé au communisme soviétique. Le Parti républicain a depuis longtemps compris les avantages électoraux qu’il y avait à instrumentaliser ce terme en associant leurs adversaires à une idéologie communément considérée comme étrangère aux États-Unis. Dans ce contexte, la volonté de Bernie Sanders de se présenter comme l’apôtre d’un « socialisme démocratique » (democratic socialism) recouvre une dimension foncièrement radicale. Son projet, qui vise à profondément changer la société étasunienne, a une double orientation politique et idéologique dont il s’agira ici de sonder les paramètres.
A. La lutte des classes et radicalisation de la démocratie.
L’une des grandes réussites de Bernie Sanders aura été de parvenir à repopulariser un discours de classe longtemps délaissé par les deux grandes familles du bipartisme étatsunien. Selon Heather Gautney, les questions de classes étaient bien au cœur de la campagne présidentielle de 2016 : « Class did end up as the fundamental organizing principle of US politics in 2016 » [50]. Lors de sa campagne présidentielle de 2016, Sanders s’est inscrit dans la lignée d’OWS en proposant une vision de la société étatsunienne comme étant divisée en deux classes antagonistes : les 99% contre les 1%, incarnant respectivement le peuple et les élites. Au fil de ses discours, Sanders souligna avec insistance le niveau grotesque atteint par les inégalités économiques dans le pays : « Unbelievably, and grotesquely, the top one-tenth of 1 percent owns nearly as much wealth as the bottom 90 percent » [51]. Une critique morale vint ainsi renforcer le message économique de Sanders.
Son discours de classe soutenait par ailleurs sa critique de la démocratie étatsunienne, jugée à bout de souffle car corrompue par le pouvoir de l’argent et des grands intérêts capitalistes. Selon lui, la problématique centrale de l’inégalité économique est intrinsèquement liée à un déficit démocratique :
The rich get much richer. Almost everyone else gets poorer. Super PACs funded by billionaires buy elections. Ordinary people don’t vote. We have an economic and political crisis in this country and the same old, same old establishment politics and economics will not effectively address it [52].
Ainsi convient-il de redonner au peuple sa souveraineté :
Today, we stand here and say loudly and clearly that ; ’Enough is enough. This great nation and its government belong to all of the people, and not to a handful of billionaires, their Super-PACs and their
lobbyists [53].
Et de radicaliser la démocratie américaine en incluant autant que possible le peuple dans le processus décisionnel :
The political revolution strives for the not-so-radical idea that we should have a government that represents all of the people, and not just the wealthy and powerful special interests. That goal will not be achieved unless we revitalize American democracy and bring millions into the political process [54].
Par son discours et ses propositions politiques, centrés sur les questions de justice socioéconomiques, ainsi que par son appropriation d’un discours de lutte des classes, opposant les élites au peuple, Sanders s’inscrit en grande partie dans la continuité du mouvement Populiste de la fin du XIXe siècle. En témoigne par ailleurs son admiration pour le syndicaliste socialiste Eugene Debs (1855-1926), qui fit l’objet d’un des films documentaires que produisit Sanders en 1979 à destination des écoles dans le but d’exposer les enfants aux idées radicales de Debs. Heather Gautney, l’une des conseillères politiques de Sanders durant sa campagne de 2016, raconte que l’une des premières choses qu’elle avait lu concernant Sanders était qu’il gardait toujours dans sa poche un porte-clé à l’effigie de son mentor [55]. Pour Sanders, la question des inégalités économiques est indissociable de la problématique démocratique dans la mesure où les 1% les plus riches sont également ceux qui dirigent le pays. Afin de remédier à ce problème, Sanders propose de créer un large mouvement des 99%, capable de porter les revendications du peuple : « We must create a vibrant democracy where the voices of all people are heard » [56]. Comme ce fut le cas pour OWS, la revendication de souveraineté populaire constitue chez Sanders la pierre angulaire permettant aux diverses revendications de converger et d’aboutir à la formation d’un large mouvement « du peuple ». Il rejoint ainsi la théorisation de populisme telle que formulée par Ernesto Laclau et Chantal Mouffe ; dans les cas d’OWS et de Bernie Sanders, c’est bien le prisme populiste des 99%, englobant des revendications à la fois démocratiques et économiques, qui permet la création d’un « peuple » dont il s’agit de faire valoir la volonté. Selon Sanders, la politique est essentiellement affaire d’identité dans le sens où la mobilisation de la population dépend éminemment de sa capacité à s’identifier à un mouvement et aux revendications de celui-ci.
B. Changer les mentalités pour réaligner le Parti démocrate avec sa vocation sociale.
Dans Where We Go From Here, le livre qui relate les activités du sénateur entre 2016 et 2018, Bernie Sanders explique que sa campagne présidentielle a toujours eu pour dessein d’être plus qu’une simple campagne politique : « We were about more than a political campaign. We were about building a movement » [57]. Cela implique en filigrane un projet sur le plus long terme que l’on pourrait qualifier d’ « hégémonique », dans le sens gramscien du terme, c’est-à-dire un projet de redéfinition de l’orthodoxie idéologique dominante. Dans Where We Go From Here, Sanders insiste sur l’impact idéologique qu’a eu sa campagne, notant que des idées auparavant perçues comme marginales sont désormais devenues populaires au point d’avoir intégré le mainstream politique : « […] the ideas that we have proposed, once considered ‘extreme’ and ‘unrealistic,’ are now widely supported by the American people. Given a chance to be heard and debated, these proposals have become part of mainstream consciousness » [58]. Heather Gautney dresse un bilan comparable, lorsqu’elle écrit : « The Bernie Sanders campaign crashed the Democratic Party in 2016 by exposing the class interests its leadership represented and by expanding the horizon of political possibility in America » [59]. L’impact de la campagne présidentielle de Bernie Sanders se remarque notamment dans l’évolution des mentalités autour de la notion de « socialisme ». Dans un sondage Gallup d’octobre 2018, 23% des Américains (moins d’un sur quatre) entendaient le socialisme comme garant d’une certaine forme d’égalité ; mais ils n’étaient plus que 17% à l’associer encore à une prise de contrôle de l’économie par l’État, contre 34% (le double) en 1949 [60]. Alors que le terme était historiquement associé à une idéologie non-américaine, donc subversive, et au concept de nationalisation des moyens de production, la perception et la compréhension qu’en ont aujourd’hui les Américains, notamment les jeunes, s’est considérablement élargie. Un pourcentage croissant de la population l’associe désormais à la notion d’égalité et à la provision d’aides gouvernementales, ce qui démontre que le terme recouvre des réalités suffisamment disparates pour être compris de manières très différentes par les Américains. Suite aux campagnes présidentielles de Sanders, la gauche étatsunienne a donc gagné en visibilité. En témoignes également l’explosion du nombre d’adhérents au Democratic Socialists of America (DSA), une organisation de gauche ouvertement socialiste, qui passa de 6000 membres à sa création en 1982, à plus de 90000 aujourd’hui, ainsi que la popularité de revues aux contenus ouvertement socialistes, telles que Teen Vogue ou Jacobin.
En parallèle, la stratégie idéologique de Sanders comprend également une stratégie de réalignement du Parti démocrate qui vise à le pousser vers la gauche, et donc à le ramener à sa vocation première [61]. En effet, depuis les années 1990, le Parti démocrate s’est manifestement éloigné de son rôle de défenseur des plus faibles, adoptant une rhétorique centrée sur l’idée de responsabilité individuelle plutôt que sur l’idée d’assistance de l’État. C’est ainsi qu’en janvier 1996, durant son discours sur l’état de l’Union, Bill Clinton déclara : « The era of big government is over ». Krystal Ball explique :
Clinton’s embrace of the meritocracy led to a new economic vision. Clinton’s economic philosophy rejected the notion that everyone was worthy of a decent life in favor of a new vision in which everyone was worthy of competing in the meritocracy for a better life. He abandoned Freedom from Want for all to Freedom to Compete in the Meritocracy for all. Freedom from Want implies that it is our responsibility as a society to ensure that even the least of these can live a life of dignity. […] Freedom to Compete on the other hand, requires little of society. The burden of success rests on each individual’s ability to compete [62].
Pour Sanders, c’est bien le processus de centrisation, donc de droitisation, du Parti démocrate qu’il faut freiner et inverser. Pour ce faire, il faut que le Parti redevienne le défenseur des intérêts du peuple : « Our goal must be, to quote Abraham Lincoln at Gettysburg, to create a political party ‘of the people, by the people, for the people.’ And that is what I want the Democratic Party to become » [63]. Selon Sanders, un tel projet ne peut que s’appuyer sur une mobilisation à grande échelle des grassroots : « […] we need an unprecedented grassroots political movement to stand up to the greed of the billionaire class and the politicians they own » [64]. Il s’agit donc de mettre en place une stratégie de confrontation avec l’establishment du Parti démocrate dans le but de faire pression sur les instances du parti et, in fine, de réorienter son corps de doctrine. C’est dans ce but que Sanders appelle le Parti démocrate à revenir à sa vocation sociale, qu’il convient d’aller chercher du côté de grandes figures représentatives du libéralisme Démocrate, et notamment du New Deal de Franklin Delano Roosevelt :
Over 80 years ago, Franklin Delano Roosevelt helped create a government that made transformative progress in protecting the needs of working families. Today, in the second decade of the 21st century, we must take up the unfinished business of the New Deal and carry it to completion. This is the unfinished business of the Democratic Party and the vision we must accomplish.
En situant son propre projet politique dans le sillon de celui du New Deal, Sanders cherche de toute évidence à l’inscrire dans le cadre de l’orthodoxie dominante : « […] by linking democratic socialism to New Deal liberalism, Sanders was bringing democratic socialism into the lexicon of mainstream American politics » [65].
À bien des égards, cette stratégie a porté ses fruits. En plus d’avoir contribué à une évolution de mentalités sur un bon nombre de sujets, Sanders a également participé à l’élaboration du programme politique démocrate le plus progressiste de ces dernières décennies : « the 2016 platform did at least nominally set a baseline policy agenda that is far more progressive than what the party has committed itself to over the last several decades » [66]. Lors de la campagne de 2020, Sanders a également réussi à pousser Joe Biden vers la gauche [67]. Sur diverses questions, tels que le climat, l’éducation ou encore l’économie, le candidat démocrate a ainsi adopté des positions plus progressistes que celles qu’il avait défendues durant les primaires. En outre, sa rhétorique s’est faite plus ouvertement combative et Biden a délibérément cherché à se positionner comme un défenseur des travailleurs. Dans un tweet publié le 1er mars 2021, le président annonçait ainsi son soutien pour les travailleurs de l’Alabama dans leur quête pour la création d’un syndicat [68]. Tentant de mobiliser à la fois la base progressiste de son parti et les électeurs plus centristes lors des élections de mi-mandat de 2022, la stratégie de Biden a combiné une dénonciation du radicalisme républicain [69] à une volonté d’exploiter le progressisme d’une partie de sa base en dénonçant les excès du capitalisme tout en se présentant comme le défenseur de la classe laborieuse [70].
Conclusion
La crise de 2008 a incontestablement joué un rôle de catalyseur politique, entraînant dans son sillage une véritable restructuration du débat public. À droite comme à gauche, nombreux furent ceux et celles qui se sont mobilisé.e.s pour dénoncer à la fois les conséquences de cette crise et sa gestion par l’administration en place. Le contexte de crise et d’érosion du consensus néolibéral a par ailleurs accompagné le réveil de la gauche étatsunienne, qui s’est d’abord manifesté à travers le mouvement OWS avant de prendre une forme plus explicitement politique sous l’égide du candidat Bernie Sanders. Très rapidement, la critique de la crise et de l’administration Obama s’est élargie pour se muer en dénonciation de l’orthodoxie idéologique dominante et du fonctionnement de la démocratie étatsunienne, faisait ainsi écho aux Populistes du XIXe siècle qui avaient eux aussi adossé leur contestation de l’orthodoxie à la reconnaissance d’une contradiction inhérente à la Constitution étatsunienne, entre d’un côté sa promesse de souveraineté populaire et de l’autre le fonctionnement élitiste des institutions politiques du pays. Le renouveau de cette sensibilité populiste a été porté sur le devant de la scène par OWS et Bernie Sanders, lesquels ont mobilisé un discours de classe d’inspiration populiste dénonçant les abus des 1% et réclamant de rendre au peuple sa souveraineté. Mobilisant une opposition peuple-élite, ce discours de classe s’est caractérisé par une rhétorique majoritaire, laquelle se démarqua radicalement de la rhétorique du libéralisme démocrate des années 1960 et 1970, caractérisée par une insistance sur les questions identitaires. À l’inverse, la gauche de Sanders se veut davantage rassembleuse, souhaitant créer une coalition majoritaire capable d’imposer un programme de facture progressiste et, in fine, d’infléchir le mainstream démocrate. Comme pour les Populistes du XIXe siècle, l’enjeu est celui d’une remise en question de l’orthodoxie dominante.
Grâce, en grande partie, à OWS et aux campagnes présidentielles de Sanders, le discours de classe s’est désormais imposé dans le débat public aux États-Unis. C’est incidemment le constat que font Astra Taylor et Jonathan Smucker, tous deux actifs dans le mouvement OWS, et pour qui l’occupation de Zuccotti Park représenta un véritable tournant pour la gauche étatsunienne, qui s’en trouva considérablement revivifiée. Dans un article intitulé « Occupy Wall Street Changed Everything », et publié en septembre 2021, les auteurs-activistes écrivent :
Ten years later, the significance of Occupy Wall Street is undeniable. Occupy inaugurated a new era of defiant protest and wan an early expression of the populist wave that continues to surge across the American political scene. It helped revitalize a moribund American left, ushering in a social-movement renaissance across a range of issues, including racial justice, climate change, debt cancellation, and organized labor. And Occupy offered a crash course in collective action for a generation of organizers now in ascendance [71].
Si 2008 a effectivement contribué à remobiliser la gauche, l’élection de Donald Trump en 2016 a également constitué un véritable électrochoc. La présidence de Barack Obama, en contribuant à l’ouverture de l’horizon des possibles, avait été témoin d’une explosion de revendications contestataires liées en grande partie à des espoirs déçus. C’est durant son mandat qu’apparurent des mouvements sociaux tels que Fight for 15, la campagne Boycott, Divestment and Sanctions movement (BDS) en solidarité avec la Palestine, la protestation de Standing Rock contre le pipeline Dakota Access et, naturellement, Black Lives Matter. Avec l’élection de Donald Trump, ces mobilisations des grassroots n’ont fait que s’étendre encore davantage au sein de la société. Sous le mandat de Donald Trump, la gauche s’est rassemblée et mobilisée de manière importante. En témoigne notamment la fameuse Women’s March, ainsi que les mobilisations contre le « muslim ban », visant à interdire l’entrée sur le territoire étatsunien des citoyens de plusieurs états musulmans, qui eurent lieu quelques jours seulement après l’investiture du président.
Cette gauche est essentiellement plurielle et hétérogène mais se rejoint dans un sentiment commun d’aliénation vis-à-vis de l’establishment démocrate. Depuis la campagne de Bernie Sanders, cette gauche a adopté une stratégie de confrontation vis-à-vis de cette élite qu’elle juge déconnectée du peuple, et cherche désormais à « occuper » le Parti afin d’en redéfinir le corps de doctrine. À l’occasion de la fameuse « vague bleue » des élections de mi-mandat de 2018, de nouvelles figures politiques issues de la gauche se sont frontalement opposées à cet establishment et sont venues renouveler les rangs des représentants à la Chambre. Repérée par l’organisation Brand New Congress, fondée à la suite de la campagne de Bernie Sanders en 2016, et portée par une mobilisation des grassroots, Alexandria Ocasio-Cortez devint rapidement le visage de cette gauche étatsunienne en pleine renaissance. Accompagnée de Ilhan Omar, de Ayanna Pressley, et de Rashida Tlaib, elle fit son entrée à la Chambre des Représentants en 2018 après avoir délogé de son siège Joe Crowley, qui fut le représentant démocrate du quatorzième district de New York durant vingt ans. Le réveil de la gauche a donc considérablement affecté le débat public et le Parti démocrate, qui se trouve désormais tiraillé entre son establishment, plus centriste, et ses grassroots, qui tentent de pousser le Parti vers la gauche. Ce rapport de force a d’ailleurs été illustré durant les premiers mois de l’administration Biden, et notamment lors des débats internes autour du passage de l’ambitieux projet législatif Build Back Better, largement soutenu par l’aile progressiste du Parti mais entravé par des personnalités plus centristes, et notamment le sénateur de Virginie Occidentale Joe Manchin III et la sénatrice de l’Arizona Kyrsten Sinema. Plus que jamais, le Parti démocrate est aujourd’hui rongé par une guerre intestine entre des factions qui portent des projets politiques radicalement différents, eux-mêmes adossés à différentes acceptions du libéralisme démocrate. Reléguée au second plan depuis plusieurs décennie, la frange progressiste du Parti est aujourd’hui bien éveillée, alimentée en partie par un discours de classe remis au goût du jour par les mobilisations sociales et politiques de l’après-crise financière. Reste à savoir si elle sera en mesure de durablement infléchir le corps de doctrine du Parti démocrate étatsunien.